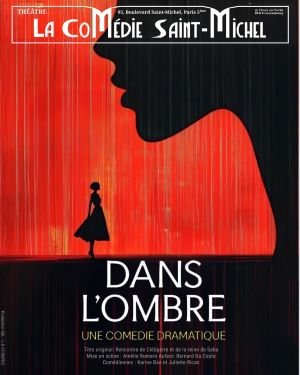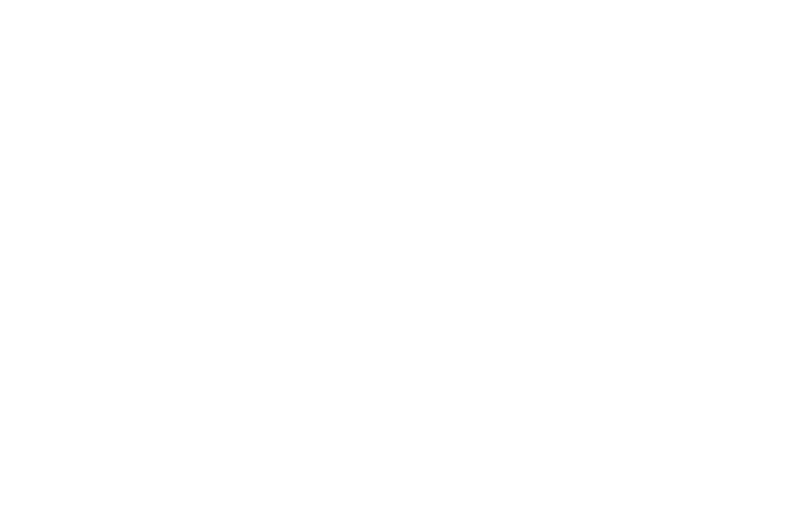Jef Aérosol : « Je veux aller à la rencontre des gens »
| Jef Aérosol peuple les rues de ses pochoirs depuis trente ans. Retour sur le parcours d’un artiste puissamment habité.
La culture musicale et artistique de vos années de jeunesse n’a jamais cessé de vous nourrir. Quel souvenir gardez-vous de cette période ? Je suis né en 57, en même temps que le rock. J’ai eu dix ans quand s’est formé le mouvement hippie, avec l’été de l’amour à San Francisco. J’ai eu vingt ans en 77, au moment de la vague punk. Trois dates qui résument une époque effervescente, marquée par la révolution pop, au sens musical aussi bien qu’artistique. J’ai grandi à Nantes, et j’étais un petit garçon sage, très romantique et fleur bleue. Dans cette France provinciale des années 50 et 60, je n’ai eu de cesse de trouver les brèches qui permettaient d’échapper au monde sérieux des adultes. A l’époque, le fossé des générations était gigantesque, infranchissable ! La culture de nos parents, c’était celle du travail. Tout ce qui venait de Londres et de New York a été un rêve incroyable : on commençait alors à parler des Beatles, ou des Beatniks… Je m’y suis jeté à cœur perdu, et je me suis construit sur ce fantasme.
Bien sûr. C’est en 1968, alors que j’entrai en sixième, que la culture visuelle a commencé à gagner la province et la rue. On voyait Twiggy et le « swinging London » aux actualités. Je me souviens des lampes psychédéliques et des chaises Knoll d’un magasin devant lequel j’aimais passer. Mais surtout des pochettes de 45 tours : Dutronc, Françoise Hardy, Antoine…. J’avais un copain dont les parents tenaient un bistro, ils faisaient venir des 45 tours des Etats-Unis pour leur juke-box ! Certaines de ces pochettes étaient faites au pochoir. Je n’ai plus arrêté de collectionner les vinyles — j’en ai plus de 10’000 aujourd’hui. Tous les étés, j’allais un mois en Angleterre. J’en ai ramené mes premiers posters, mon premier portrait de — je l’ai encore…. Tout cela a forgé mon goût pour les images, et je n’ai plus cessé de dessiner, de même que j’ai toujours fait de la musique… Comment est né votre premier pochoir ? Comme beaucoup, au début des années quatre-vingt, j’ai largué les crayons et les pinceaux pour faire des collages, des photocopies, des polaroïds, etc. Je faisais des pochettes pour les groupes des copains. Je partais de photos dont je détourais les bords. Je déformais, je bidouillais beaucoup… J’ai été très influencé par le collectif Bazooka, qui pour moi est l’exemple de la désacralisation de l’objet d’art dans les années soixante-dix, plus fort encore que Support/surface, ou Pollock. Ils m’ont beaucoup influencé, de même que les travaux des graphistes Roman Cieslewicz et Milton Glaser. En 1983, j’ai été nommé professeur d’anglais à Tours, après avoir réussi le Capès d’anglais. Pour rencontrer des gens, j’avais le choix entre traîner et chercher les bars où se réunissaient les musiciens, trouver les radios libres du coin, ou alors balancer ma carte de visite – ce que j’ai fait très vite, sur les murs de la ville. Mon premier pochoir, c’était un photomaton que j’ai agrandi. C’était déjà le visage humain qui vous fascinait ? Absolument. Même au lycée, je n’ai jamais fait que des portraits. Je m’intéresse très peu à la nature. Même si je peux être sidéré par la mer ou la montagne, au bout de trois jours, je m’emmerde copieusement ! Par contre, j’aime le mouvement de la foule. J’ai cinquante-cinq, et le mystère de l’humain continue de me sidérer. De même que le nombre d’êtres qui sont déjà passés sur ce globe, ce qu’ils ont fait, ou n’ont pas fait. Je suis encore incapable de savoir si l’homme est bon ou mauvais, mais cela me fascine. Or ces questions que je ne cesse de me poser passent par l’émotion du regard. Un mort, c’est un corps dont le regard s’est éteint. Ce qui est curieux, d’ailleurs, c’est que sur beaucoup de statues grecques, la pupille n’est pas représentée et l’expression est quand même là. Le regard, qu’on le détourne ou l’affronte, est ce qui détermine la relation entre les gens. Tout est dans l’œil. Pendant longtemps, sur les murs, j’ai surtout fait des visages.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=XNAzaL6e-xo[/embedyt]
Si, bien sûr. J’en profite pour agrandir les murs de la chambre d’adolescent sur lesquels j’épinglais les photos de mes idoles. Maintenant, je les pose dans les villes par lesquelles je passe. Mais j’ai souvent croisé des gens qui appartenaient à une génération pour qui Dylan ou Hendrix ne voulaient rien dire. Les niveaux de lecture des images dans la rue sont aussi multiples que les passants. L’essentiel, c’est que chaque être humain, qu’il soit célébrissime ou inconnu, est avant tout un regard, un visage, une émotion. Le pochoir permet des rencontres improbables, voire anachroniques, et donc de faire se côtoyer Oscar Wilde et Alain Bashung, Gandhi et Patti Smith, le petit accordéoniste qui fait la manche et Salvador Dali ! L’ unité d’images, puisqu’on utilise le même support – les murs de la ville -, et le même outil, le pochoir, aplatit les différences ; on a l’impression que ces gens sont sur le même pieds. Pourquoi travailler le noir ? Je pars du noir et je vais vers la lumière. On voit d’abord la silhouette générale, pour peu à peu distinguer le visage, le corps, et arriver aux yeux. Mais c’est aussi comme ça qu’on rencontre les gens dans leur âme… Les amitiés se font d’abord dans du flou, et la lumière peu à peu se fait sur ce qu’ils sont vraiment. J’aime que mes ombres soient des ombres vives : même si les gens sont morts depuis longtemps, je les ressuscite, je leur redonne vie sur le mur et ils appartiennent à nouveau à la rue. Ils se mélangent au flux des passants. Parce qu’ils sont fixes, ils sont un arrêt sur image du film de la vie, ou de la ville. Il y a un effet de miroir, d’identification. Vous aimez entrer dans le quotidien des passants ? Ca me plaît de rencontrer les gens par le biais du mur. Je ne cherche pas à les brusquer. J’ai toujours été non-violent. J’ai été un peu punk, mais aussi un peu hippie – d’ailleurs c’était presque la même chose, malgré des oripeaux différents : entre le « love and peace » et le « no future » il y avait beaucoup de ponts. Je veux aller à la rencontre des gens sans jamais les violenter, proposer sans imposer. J’aime que mon travail puisse séduire les jeunes comme les vieux, les branchés et ceux qui sont supposés ne rien y connaître, les riches et les pauvres… Si tant est que je délivre des messages, j’aime penser qu’ils sont plus poétiques que politiques, même s’il y a parfois de petits clins d’œil sociaux ou politiques.Parmi vos anonymes, il y a le « sitting kid ». C’est un personnage auquel les gens se sont beaucoup identifiés ! Ils s’y sont reconnus, ou y ont retrouvé leurs gamins. Je crois que l’émotion qui s’en dégage vient aussi du fait qu’on ne sait pas s’il est triste ou rêveur. Je m’y suis attaché, moi aussi. Alors que les autres vont, viennent, celui-là, je le trimballe partout ou je vais. Les pochoirs s’abîment et meurent au bout d’un moment, et souvent je ne les redécoupe pas. Lui, je l’ai déjà fait trois ou quatre fois dans différentes tailles. Il est devenu un peu iconique dans mon travail, comme la flèche rouge.[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=aYkp977EVBw[/embedyt] Cette flèche, depuis quand l’utilisez-vous ? Elle est apparue de façon aléatoire, dans les années 80. Elle allait et venait, puis est restée. Quand j’ai commencé, le design utilisait beaucoup de signes graphiques de ce genre. Au fur et à mesure, le besoin de composer mon image et d’organiser l’espace, un peu comme sur du papier ou une toile, s’est imposé. Cette flèche me permet de créer des diagonales, des marges, un cadre là où il n’y en avait pas. Mais aussi de souligner le besoin d’accumulation, de répétition. Je voulais montrer que le pochoir était un outil qui permettait de reproduire la même image à volonté. J’aimais répéter un visage, par exemple, un peu à la façon des sérigraphies de Warhol, qui m’a beaucoup influencé, des photomatons, ou encore du photographe Duane Michals. Peu à peu, la flèche est devenue ma marque de fabrique. Pour moi, une œuvre n’est pas terminée tant que je ne l’ai pas faite, et quand je passe devant un pochoir où elle a été effacée il me semble qu’il manque quelque chose. J’aime dire que c’est une flèche qui donne du sens dans tous les sens.
C’est ce que je j’appelle le travail hors contexte. Dans la rue, je considère qu’il n’y a pas de bord. Si vous voulez faire le tour de mon œuvre, vous ferez le tour de la terre pour arriver dans la même rue, de l’autre côté… C’est extraordinaire de peindre un personnage dans la rue et de se dire que le fond, c’est l’univers ! Et qu’il change constamment, comme la lumière… L’usure, le vent, les saisons, en font un tableau différent. L’œuvre n’est pas figée, elle est en devenir — jusqu’au moment où elle disparaîtra. Quand on travaille sur une toile, par exemple (mais j’utilise aussi beaucoup de cartons, ou d’autres supports), on est déterminé par quatre angles et quatre lignes. Et il faut réussir à tout placer là-dedans. Sans contexte, le tableau doit pouvoir exister pour lui-même. J’ai une conscience aiguë du cadre, comme un photographe. Donc je casse et je coupe. J’aime bien avoir un portrait dans un coin, des blancs…. Quand vous investissez un lieu chargé d’un imaginaire fort, comme Venise ou la grande muraille de Chine, comment procédez-vous ? On pourrait penser qu’il est sacrilège ou provocateur d’intervenir dans des lieux qui appartiennent ainsi au patrimoine mondial. Mais pour moi, c’est exactement l’inverse d’un manque de respect pour l’histoire ou les vieilles pierres. Aussi bien sur la muraille de Chine qu’à Venise, il était hors de question que je peigne directement. Dans ces cas-là, je peins sur nappe en papier, un matériau léger et fragile. Ce papier très fin permet d’épouser la pierre, le ciment, le crépis ou la brique. L’œuvre entre vraiment dans le mur. Si on recule, on a l’illusion qu’il a été peint. Et je sais que les intempéries ou un coup de kärcher se chargeront de nettoyer. C’est un hommage à ces lieux. Il s’agit bien d’habiter des espaces déjà habités par des populations, sur lesquels je viens ajouter, avec humilité et respect, une petite couche de plus. Le cœur de la texture urbaine est là comme un arbre dont on coupe le tronc et dont on voit toutes les strates. L’écorce n’est que la dernière, mais derrière, il y a des siècles de vie. J’essaye aussi d’entrer dans cette histoire.Dans un lieu historique comme Venise, je sens des vibrations très puissantes. Là, j’ai placé Dirk Bogarde dans un extrait du film Mort à Venise.Quel regard portez-vous sur vos trente ans de pochoir ? Un regard émerveillé, ébahi que la vie m’ait offert la possibilité de montrer mon travail partout, d’en vivre. Et surtout de faire tant de rencontres extraordinaires grâce au pochoir. Le pochoir, c’est un cri d’amour. On cherche tous, dans la vie, à rencontrer l’autre. On peut le faire avec un métier, la littérature, le cinéma, la religion, que sais-je. Moi, j’ai peint des centaines de gens, et mes amis sont aussi tous ces visages que j’ai peints sur les toiles. Même si mon pochoir préféré, c’est évidemment le prochain ! Je suis tourné vers l’avenir, mais j’adore aussi tout ce que le passé m’a offert d’inspiration et de rencontres…Sophie Pujas [Visuels : Jef Aerosol, 2012. 60×60 cm. Pochoir sur toile. Courtesy galerie Magda Danysz] |
Articles liés

Ce week-end à Paris… du 6 au 8 février
Art, spectacle vivant, cinéma, musique, ce week-end sera placé sous le signe de la culture ! Pour vous accompagner au mieux, l’équipe Artistik Rezo a sélectionné des événements à ne pas manquer ces prochains jours ! Vendredi 6 février...

L’Athénée présente une soirée cabaret sur le thème des Sept Péchés Capitaux
Amies de longue date, la mezzo-soprano Fleur Barron et la soprano Axelle Fanyo se retrouvent à l’Athénée pour une soirée dédiée au cabaret, sur le thème des sept péchés capitaux. A leurs côtés, le pianiste Julius Drake, habitué des...

Le spectacle musical “Brassens, l’amour des mots” à retrouver à La Scène Libre
Georges Brassens revient sur scène. Pas pour raconter sa vie, mais pour nous ouvrir la porte de son atelier intérieur : un lieu de liberté, d’humour, de poésie et de fraternité, où les mots se cherchent, se heurtent, se répondent et...