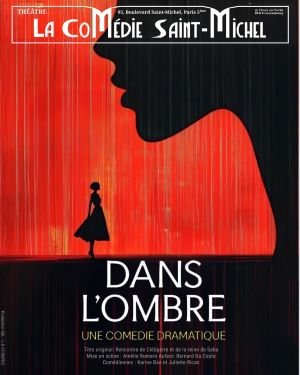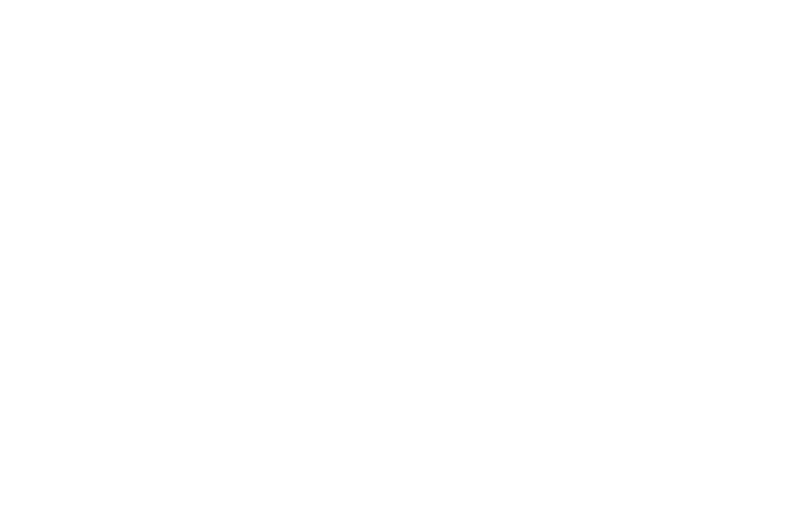La vitalité des symboles à l’ère moderne et postmoderne
|
La vitalité des symboles à l’ère moderne et postmoderne Le 23 mars 2015 |
Le symbole se dresse entre la chose et l’idée, aussi l’utilise-t-on depuis toujours, pour ainsi dire, afin de communiquer, mais aussi de créer des liens parfois inattendus, inédits voire même mystiques. Ces liens peuvent être compris par une communauté donnée lorsqu’ils ont fait l’objet d’une codification, ou au contraire, être le fondement d’un langage crypté, réservé à quelques initiés — tout du moins à ceux qui voudraient s’aventurer au-delà de la simple apparence des choses.
L’efficacité du recours au symbole pour exprimer des faits, des sensations ou des phénomènes qui dépassent la simple perception matérielle en a fait un ressort poétique particulièrement apprécié au XIXe siècle, qui a vu naître un courant — ou plutôt une nébuleuse — symboliste européen, mais qui a continué à être d’une grande actualité tout au long du XXe siècle jusqu’à nos jours. L’utilisation du symbole a ainsi permis dans un premier temps de trouver une alternative à une expression réaliste, et notamment naturaliste, mais aussi, plus globalement, de répondre aux angoisses humaines face à l’industrialisation et au triomphe de la machine, tout en laissant libre cours à l’autonomie de la subjectivité. Dès lors que l’on considère l’art comme un langage, et plus encore une affaire de transmission doublée d’un fait éminemment social, il est important de souligner la place qu’occupent les symboles au cœur de la création artistique, jusqu’aux créations les plus contemporaines. Le symbolisme, au crépuscule du XIXe siècle Le symbolisme a eu beaucoup de visages, d’autant plus nombreux que chaque artiste, tout comme chaque critique d’art a pu être tenté d’en proposer sa définition personnelle. En outre, ce mouvement a connu des développements différents au sein d’un engouement général à l’échelle du continent européen. En France, le milieu du XIXe siècle a vu de nombreux artistes affirmer que la peinture est « un art essentiellement concret qui ne peut consister que dans les représentations des choses réelles et existantes », pour citer Gustave Courbet (1819-1877). Prenant le contrepied de ces positions qui se concentrent essentiellement sur la perception visuelle, la nouvelle génération d’artistes nés dans les années 1860 a réinvesti le domaine du rêve et de l’imaginaire. Ce renouveau touche tous les arts, mais en premier lieu la littérature, à laquelle les arts plastiques emboîtent promptement le pas. Ainsi, en 1886, Jean Moréas fait paraître le Manifeste du Symbolisme dans le Figaro. La définition qu’il en donne reste très vague, expliquant que « La conception du roman symboliste est polymorphe », que le personnage s’y meut dans un monde « déformé par ses hallucinations propres », concluant sur une oxymore tout à fait symptomatique de la vision symboliste : « en cette déformation gît le seul réel ». Selon cette acception, dans la quête d’une explication du positionnement de l’homme dans le monde naturel, c’est donc l’état d’âme qui prime sur tout le reste. Au nombre des artistes que l’on classe parmi les symbolistes, on compte Odilon Redon, Arnold Böcklin, James Ensor, Max Klinger, Ferdinand Hodler ou encore les anglais Burne Jones, Watts et Beardsley — que le magazine satirique Punch surnommait Weardsley, « le bizarre ». On leur associe souvent les protagonistes de l’Art Nouveau, qui rejoignent ces premiers sur le plan onirique. Ces artistes, de même qu’une partie de la critique, ont érigé les figures de Gustave Moreau (1826-1898) et Puvis de Chavannes (1824-1881) comme les pères fondateurs de leur nouvelle peinture. Ceux-ci ont en effet prôné, dès les années 1860, un art profondément méditatif qui invite à rêver plus encore qu’à penser. Leurs œuvres sont donc souvent inspirées d’anciens mythes dont l’esprit du siècle s’était considérablement éloigné au profit d’un positivisme et d’un goût marqué pour l’épopée humaine, celle d’une histoire linéaire avançant vers le progrès. Parmi les thèmes de prédilection des artistes symbolistes figure tout un cortège de personnages hybrides, de têtes coupées et de silhouettes ambigües et pâles, popularisées par Moreau et que l’on retrouve dans Les Yeux Clos de Redon sans oublier la figure de la femme fatale, qui piège ses victimes dans une chevelure d’une invraisemblable longueur.
De tels thèmes peuvent être déclinés à l’infini en jouant précisément sur l’élément mystérieux. Ainsi, au sein d’une même œuvre, tout un faisceau d’interprétations coexistent. En outre, elles s’infléchissent en un sens ou l’autre selon le point de vue, ou plutôt l’état d’âme, de son spectateur. Face aux Yeux Clos de Redon, il y a de quoi ressentir ce vertige : une tête gigantesque domine, énigmatique, un rivage éclairé par la lune. Ses yeux sont-ils fermés par la méditation, le sommeil ou la mort ? Ne nous invitent-ils pas, en tant que spectateurs, à faire de même, et à explorer notre monde intérieur ? On touche là à ce qui fonde tout le pouvoir des images symbolistes, qu’ils appellent symboles en renouvelant ainsi tous les codes de lecture présupposés : ce sont avant tout des images profondément évocatrices, loin de tout symbole prédéterminé. Ainsi, si l’art de la Renaissance ou de la période classique recourait abondamment aux symboles pour crypter certains messages, une forme étant associée à une signification précise sur le mode du signifié et du signifiant, le symbolisme investit ses images d’un pouvoir encore plus grand, celui de convoquer directement, par le biais de l’émotion, une multiplicité de sens. Si, grâce au symbole, le spectateur est appelé à investir le domaine de son expérience personnelle — et c’est là une invitation très moderne —, c’est aussi le cas de l’artiste. En effet, c’est sous les traits de Camille Falte, la femme d’Odilon Redon, qu’apparaît l’étrange vision qui envahit l’espace de la toile intitulée Les Yeux Clos. L’œuvre de James Ensor contient aussi une importante part autobiographique. Peuplées de têtes de morts, de squelettes et de masques, ses toiles livrent une vision caustique d’un monde sans doute jugé trop fade par l’artiste, qui en caricature les travers au moyen des accessoires de carnaval au milieu desquels il a passé son enfance, dans la boutique que tenaient ses parents. On comprend par là comment une bonne part des artistes symbolistes, à l’instar d’Ensor, ont été amenés à écrire leur mythologie personnelle au fil de leurs créations. Cette affirmation de l’individualisme, de l’autonomie subjective a bien sûr suscité de nombreux remous et incompréhensions… avant d’avoir une longue postérité au XXe siècle. Symbolisme et psychanalyse Il apparaît en effet que des thèmes tels que la féminité à la fois dangereuse et séductrice, la mort, l’étrange — et en particulier « l’inquiétante étrangeté » freudienne — ou encore le rêve, qui ont fait partie intégrante du paysage symboliste, ont continué à captiver l’attention des artistes tout au long du XXe siècle jusqu’à nos jours. Le crâne en diamants de Damien Hirst est d’ailleurs populairement appelé « première icône du XXIe siècle ». De thèmes sulfureux, comment ces éléments ont-ils pu se faire cette place au soleil ? Un premier élément de réponse vient sans doute du fait que tous ces thèmes font partie des préoccupations ou des angoisses humaines, tout simplement. Ces facettes plus sombres de l’homme sont longtemps tombées sous le coup d’une certaine forme de tabou social. L’hypothèse de l’inconscient construite par Freud et plusieurs événements dramatiques du XXe siècle allaient cependant donner lieu à une réanimation de tels symboles, extrêmement efficaces lorsqu’ils s’agit de sonder les limites de notre conscience. « L’Ombilic du Rêve », une récente exposition du Centre Wallonie Bruxelles à Paris, actuellement visible au Musée Royal de Mariemont dans le cadre de Mons 2015, montre bien la permanence de ces thèmes en traçant des correspondances entre plusieurs voix artistiques : celles de Félicien Rops, de Max Klinger, deux contemporains du mouvement symboliste, et celles d’Alfred Kubin et Armand Simon, tous deux témoins de la Seconde Guerre mondiale. Pour ce dernier notamment, que l’on connaît pour ses illustrations des Chants de Maldoror de Lautréamont — paru en 1869 puis en 1874 —, la sexualité est inextricablement liée à la mort, la femme restant pour lui une figure énigmatique et inaccessible… ce qui est loin d’être le cas pour nombre de ses pairs surréalistes. Là encore, on se rend compte que si les symboles constituent une partie des briques élémentaires avec lesquelles œuvre l’artiste, ils sont agencés et rendus cohérents grâce à un fil conducteur : la mythologie personnelle de l’artiste. En somme, il pourrait donc y avoir autant de symboles qu’il y a de volontés créatrices pour leur donner un sens… La mort du symbole ? De là, face à un tel foisonnement, on en vient à se demander si tout peut être un symbole, questionnement qui n’est pas loin de rappeler celui qu’ont mis en avant Duchamp puis Warhol, à savoir : tout peut-il être de l’art ? L’artiste allemand Joseph Beuys (1921-1986) semblerait répondre de manière positive à ces deux interrogations par sa pratique tout à fait inédite et sa mythologie personnelle pour le moins originale. En effet, ce dernier, qui était pilote dans la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale, aimait à raconter qu’il avait été recueilli par des nomades tatares lors du crash de son avion en Crimée. D’après le récit qu’en fait Beuys, ceux-ci l’ont nourri de miel, enduit de graisse puis enroulé dans du feutre. Ainsi, feutre, graisse, cuivre, miel et… lièvre dessinent les contours de la symbolique personnelle très particulière de cet artiste-chaman. Beuys ne se contente toutefois pas de créer des symboles, puisqu’il entend aussi mettre à mal certains d’entre eux… En effet, dans sa performance I like America and America likes me (1974) réalisée à la galerie René Block de New York, l’artiste arrive aux Etats-Unis les yeux bandés et en ambulance, évitant ainsi de toucher le sol américain. Il se fait alors enfermer dans un cage avec un coyote auquel il lit le Wall Street Journal afin de l’apprivoiser. Cette performance est d’autant plus iconoclaste qu’elle se solde par l’ultime désécration, le coyote finissant par uriner sur le Journal. On imagine que l’institution du Wall Street Journal n’est pas la seule à avoir fait les frais des coup portés par les redéfinitions que proposent l’art moderne et postmoderne. La proposition de Beuys s’inscrit parfaitement dans la mouvance de l’art contemporain décrite par le critique américain Arthur Danto, spécialiste notoire d’Andy Warhol. Ce dernier explique que l’art contemporain se caractérise par la perte de tout critère, qu’il s’agisse de notions de beauté ou même d’expériences sensibles. Les symboles, qui ont longtemps permis de faire référence à une réalité — ou une surréalité — plus vaste ou transcendante subit donc logiquement le contrecoup de ce basculement. Le bouleversement est de taille et le symbole doit également s’accommoder d’une donnée qui a pris une importance croissante au cours du XXe siècle : l’autoréférentialité de l’art, l’œuvre d’art et son processus créatif pouvant se suffire à eux-mêmes sans qu’il ne soit besoin de représenter un récit ou même une idée extérieure à la création elle-même. Sur une note plus légère, un nouveau type de symboles apparus à l’ère de la communication semble avoir actuellement le vent en poupe, à l’instar des émojis scintillants installés l’année passée par l’artiste Tré Reising à l’aéroport international d’Indianapolis, Live, Love, Laugh, Laugh Until You Cry. Cette œuvre ludique, clin d’œil à des éléments qui façonnent notre quotidien, jette un pont entre les modes de communication numériques, impalpables et notre réalité physique… rejouant ainsi parfaitement les codes du symbole, tout en se parant des attributs nouvelle génération. Art Media Agency [ © Odilon Redon, Noir Pegasus, 1900?, pastel, Hirshhorn Museum, Washington, D.C ; © James Ensor ] |
Articles liés

Ce week-end à Paris… du 6 au 8 février
Art, spectacle vivant, cinéma, musique, ce week-end sera placé sous le signe de la culture ! Pour vous accompagner au mieux, l’équipe Artistik Rezo a sélectionné des événements à ne pas manquer ces prochains jours ! Vendredi 6 février...

L’Athénée présente une soirée cabaret sur le thème des Sept Péchés Capitaux
Amies de longue date, la mezzo-soprano Fleur Barron et la soprano Axelle Fanyo se retrouvent à l’Athénée pour une soirée dédiée au cabaret, sur le thème des sept péchés capitaux. A leurs côtés, le pianiste Julius Drake, habitué des...

Le spectacle musical “Brassens, l’amour des mots” à retrouver à La Scène Libre
Georges Brassens revient sur scène. Pas pour raconter sa vie, mais pour nous ouvrir la porte de son atelier intérieur : un lieu de liberté, d’humour, de poésie et de fraternité, où les mots se cherchent, se heurtent, se répondent et...




 Des thèmes féconds invitant à l’introspection
Des thèmes féconds invitant à l’introspection